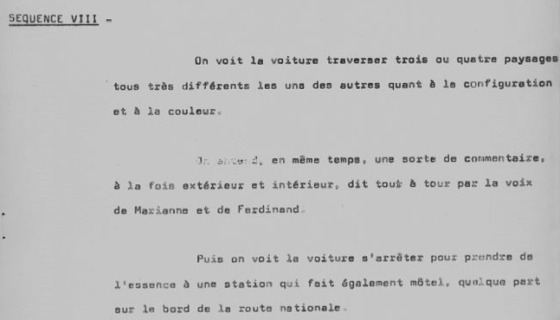La place du scénariste en France : le paradoxe d’une absence de reconnaissance.
Retrouvez la première partie de notre entretien ici.
Selon le rapport du Club des 13 [collectif formé en 2007 à l’initiative de la réalisatrice Pascale Ferran et qui a publié l’année suivante un rapport sur le cinéma français et les films dits du « milieu », intitulé Le milieu n’est plus un pont mais une faille NDLR], auquel tu as participé, le scénariste n’a jamais eu, dans la culture française, la place d’auteur qu’il pourrait mériter et qu’il occupe dans un certain nombre d’autres pays : « Comme s’il s’agissait d’un rapport dévoyé et à l’écriture et au cinéma. Tellement moins noble que celui d’écrivain. Tellement moins chic que celui de cinéaste. ». Mais l’une des raisons principales invoquées, et c’est l’une des motivations de cet entretien, est l’absence totale de connaissance du métier du scénariste et de son rôle dans l’élaboration du film. Le rapport y voit en partie l’héritage de la nouvelle vague française et de sa « politique des auteurs » qui avec le temps nous fait oublier l’aspect collectif de la conception d’un film : « Peu à peu, cette méconnaissance a imposé l’idée, à nos yeux dangereuse, que le scénario serait forcément du côté du cinéma américain, de l’efficacité du récit, et s’accompagnerait, par essence, de règles normatives qui viendraient brider l’élan si puissamment créatif du réalisateur. Vision romantique de l’art. Mensonge régulièrement démenti par les expériences des uns et des autres. » Que faire contre cette méconnaissance, et pour réhabiliter ou plutôt tout simplement habiliter, le scénariste en France ? Je pense notamment au moment de la sortie de ton film Cherchez Hortense, où tous les médias parlaient de l’écriture de Pascal Bonitzer, qui comme tu l’as dit est un grand scénariste, mais ne te mentionnaient jamais.
Sauf un article en France, dans Les Inrocks, qui était le seul à mentionner mon travail. Par contre, lors de la présentation du film au festival de Venise, on a eu des articles dans Variety, presse professionnelle américaine, et dans Screen qui est son équivalent anglais, qui me mentionnaient. Les journalistes précisaient également deux ou trois autres titres de films que j’avais écrit. Ce qui permet au lecteur, professionnel en tout cas, d’identifier un scénariste et son parcours. Les anglo-saxons font donc ce travail que les journalistes français ne font pas. Je souscris totalement à ce qui est dit par le club des 13 (j’en suis en partie responsable donc c’est normal (rires)). Il y a un effet de double peine dans le métier : ce n’est pas extraordinairement bien payé, même si on arrive à en vivre il y a toujours une forme de précarité, et surtout obtenir une reconnaissance du travail est un combat permanent. C’est effectivement un héritage de la Nouvelle Vague. Peut-être le fait d’un malentendu : ce que ces réalisateurs fustigeaient n’étaient ni la tradition, ni le récit, mais un cinéma français en léthargie. Truffaut, critique, défendait le cinéma de Renoir, Hitchcock ou Hawks.
Très concrètement, la reconnaissance de ce métier est un combat auquel je participe, à travers un syndicat qui s’appelle La Guilde [La Guilde des scénaristes français (1)], où s’est constitué un groupe cinéma. J’en suis élue, et on essaye de faire remonter nos problématiques d’auteurs auprès d’un certain nombre d’institutions. Le scénario étant ce sur quoi, plus que jamais, se décident les acteurs et se financent les films, on est vraiment en plein paradoxe ; l’objet sur lequel se construit économiquement et en partie artistiquement un film est sous-reconnu.
En plus du problème de la place des scénaristes en France, le rapport insiste sur l’affaiblissement du trio producteur-réalisateur-scénariste par le recul du producteur dans le processus initial de création, qui soumet donc le duo réalisateur-scénariste à l’influence, forcément néfaste car normative, des exigences marchandes – le producteur étant censé être un rempart permettant à ce duo de se focaliser principalement sur l’aspect artistique : « D’une certaine façon, les télévisions n’ont même plus à intervenir frontalement sur le scénario. La beauté du système, sa puissance, réside même en cela : dans la majorité des cas, les réalisateurs et leurs producteurs, ont intégré tout ou partie de leurs demandes implicites dès la conception du film. » Finalement, l’objectif de ce Club des 13, auquel tu as participé, est la défense des films dits du « milieu », contre une bipolarisation entre films à gros budgets sans prétention artistique et extrême inverse. Comment vois-tu, à l’aune de tes expériences, le rôle du scénariste dans un tel contexte, et comment, s’il ou elle le peut, participer à cette défense ?
Ce qu’on appelle les films du milieu ce sont des films entre 3 et 7 millions d’euros, qui ont une ambition de raconter une histoire singulière, avec un point de vue d’auteur, mais destinée au plus grand nombre. C’est une tradition du cinéma français, qui a toujours existé et qui est effectivement mise à mal. J’ai la chance d’être un peu dans ce cinéma-là : disons… des films du milieu-bas. Malgré des dispositifs mis en place suite au Club des 13, tout ce qui était dit à l’époque reste absolument d’actualité – voire s’est aggravé.
Donc l’enjeu est d’arriver à continuer à produire des films du « milieu » tout en restant, notamment lorsqu’on arrive à des budgets importants, indépendants des exigences de recettes ?
Je ne pourrais pas te dire que l’on n’y pense pas. Ce serait malhonnête. Un film est une aventure collective destinée à un collectif. On se pose donc la question de ce qui peut plaire, sans, bien entendu, en avoir la réponse ; il faut surtout s’en amuser. Le problème n’est pas tant les sorties en salles, mais le financement des films. Le film de Pascal Bonitzer [Cherchez Hortense] est un bon exemple : bien que ce soit une comédie avec Isabelle Carré, Jean-Pierre Bacri et Kristin Scott-Thomas, aucune chaîne de télé n’est entrée dans son financement. C’est une comédie d’auteur, donc ça n’est pas une première partie de soirée. Il y a donc une normativité, que personne ne reconnaît franchement, et qui est dangereusement intégrée par les producteurs qui disent « ça c’est bien mais je ne pourrais jamais le monter ». Ils ont intégré l’idée que quelque-chose de trop singulier ne peut pas se monter. Il faut donc résister à cette contamination par la problématique de ce qui va ou non être financé. Car on ne peut pas écrire comme ça. Et, à mon avis, on le sent un peu dans le cinéma français, les têtes ne dépassent pas beaucoup. C’est le vrai danger : cette façon doucereuse de lisser les audaces et l’imaginaire. Comme on a tous envie que les films se fassent, inconsciemment on modèle les choses pour répondre à un créneau plutôt qu’à un désir, ce qui n’est pas le but du cinéma. Le cinéma doit être une œuvre, expression d’un désir. La télé, elle, fonctionne en créneau. Ontologiquement. Il y a donc une contradiction. À la fois productive : qui nous permet de faire des films. On avance toujours avec les contradictions. Mais il ne faut pas en devenir prisonnier, il faut des producteurs courageux. Et il y en a : indépendants et qui prennent des risques.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GA11vJrSFcU]
Sans rentrer dans les plus ou moins vaines polémiques qui ont entouré le départ de Gérard Depardieu, quelle est la réaction d’une scénariste comme toi au débat lancé dans Le Monde, par le producteur Vincent Maraval (« Les acteurs français sont trop payés ! », Le Monde, 28.12.2012) sur les salaires surévalués des « vedettes » françaises ? Son constat est sévère – peut-être même exagéré ? je ne sais pas – lorsqu’il écrit, au sujet de l’année 2012 du cinéma français : « Pas un film, sauf peut-être Le Prénom, pour gommer ce que toute la profession sait pertinemment, mais tente de garder secret : le cinéma français repose sur une économie de plus en plus subventionnée. Même ses plus gros succès commerciaux perdent de l’argent. Constat unanime : les films sont trop chers. Après les films des studios américains, la France détient le record du monde du coût moyen de production : 5,4 millions d’euros, alors que le coût moyen d’un film indépendant américain tourne autour de 3 millions d’euros. Ce coût moyen ne baisse jamais, alors qu’il y a toujours plus de films produits, que le marché de la salle stagne, que la vidéo s’écroule et que les audiences du cinéma à la télévision sont en perpétuel déclin face à la télé-réalité et aux séries. » Le rapport du Club des 13, encore lui, met en avant la paupérisation grandissante des scénaristes. Un témoignage (anonyme, peut-être le tien), explique que « Le seul moyen pour un scénariste d’être mieux payé est donc de quitter le champ des films dits d’auteur pour entrer dans celui des films dits commerciaux. Il n’y a aucune promotion sociale possible à l’intérieur du cinéma artistiquement le plus exigeant. Dans ce secteur précisément, on gagne même de plus en plus mal sa vie. » En tant que scénariste, comment vis-tu cette polémique autour du salaire des acteurs ? Tu parlais de la double peine ; les scénaristes – comme d’autres participants à l’élaboration de films, autres qu’acteurs, réalisateurs, producteurs – sont-ils une fois de plus les grands oubliés ?
C’est une bonne polémique qui a eu le mérite d’affronter un certain nombre de sujets tabous. Je pense néanmoins que Maraval a exagéré sur beaucoup de choses car il y a toute une économie de films, dont Cherchez Hortense par exemple, qui sont des films à budgets serrés (le milieu-bas, encore une fois), qui font entre 500 000 et un million d’entrées, et deviennent rentables. Il ne parle que des très gros films. Où l’argent n’est pas toujours réparti de façon équitable. Comme dans toute œuvre collective, les rémunérations devraient avoir une forme d’équité. Je ne veux pas dire égalité, mais bien équité. Je sais que les techniciens notamment sont de plus en plus soumis à la pression économique, on leur demande de faire des efforts, de baisser leurs salaires, etc., tandis que les salaires des acteurs montent. C’est choquant. Mais ce n’est pas mon domaine, je ne peux parler que du scénario. Moi ma rémunération a augmenté avec l’expérience. Mais à un moment les tarifs n’augmentent plus, ou – c’est effectivement ce qui est dit par le Club des 13 – si je voulais vraiment commencer à gagner beaucoup d’argent, il faudrait que je passe dans une autre économie de film. Il y a une sorte de plafond de verre. Bon après il n’y a pas que le fric dans la vie. Mais on est quand même dans une industrie, le scénario est un des leviers essentiels du financement, et son coût est en moyenne autour de 2,5% du budget. Dans le cinéma américain, le développement représente entre 8 et 10% du budget. L’autre chose fondamentale que les producteurs doivent comprendre, c’est qu’il faut absolument, nous associer au succès du film. On ne peut pas nous demander d’être associé au risque sans être associé au succès éventuel. Ça ne marche pas. La question de la transparence des remontées de recettes est essentielle. Je sais que les producteurs ne sont pas seuls en cause, eux-mêmes sont soumis aux recettes qui remontent des distributeurs, exploitants, etc. Il y a un groupe de travail au CNC sur la question. C’est très important pour l’avenir.
Peut-être qu’on est, par le fait d’avoir choisi ce métier, des travailleurs de l’ombre et de l’arrière-boutique ; on n’a pas l’habitude d’être dans la revendication. Mais là c’est le moment de mettre le pied dans la porte. On ne fera pas tout bouger, mais il y a des choses sur lesquelles il faut avancer.
Enfin, pour terminer, étant une jeune revue, nous aimons bien demander aux personnes que nous interviewons ce qu’ils ou elles pensent de notre nom, Profondeur de Champs.
J’aime, bien sûr, la référence au cinéma. Or, si j’ai bien compris, vous n’êtes pas seulement une revue de cinéma. J’aime ce que cela évoque : une façon de regarder les choses autrement. Ne pas rester sur l’évidence, ce dont tout le monde parle, qui est dominant, parfois écrasant. La profondeur de champs devient de plus en plus difficile à saisir. Pas que sur la culture, mais aussi sur les mouvements de nos sociétés. Il y a des effets de masques très forts, dont les médias sont en grande partie responsables, et qui font qu’on ne voit qu’un aspect des choses. Donc en termes de sens j’adore votre titre. Après, est-ce que cela ne fait pas un peu revue spécialisée ? C’est pointu. Un peu solennel peut-être. Mais ambitieux. Il le faut.
Entretien réalisé par Marc-Antoine Sabaté