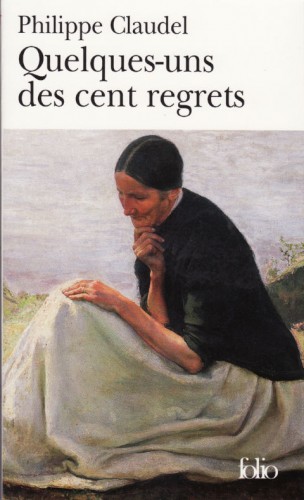« Pourquoi il faut lire : … » est une chronique littéraire qui veut replacer la beauté texte au centre de la critique. Il y est forcément question d’analyses, d’explications, de résumés, mais ce ne sont que des moyens au service d’une seule cause : donner l’envie à des lecteurs de découvrir un roman. Un roman qui peut être plus ou moins récent, plus ou moins actuel, plus ou moins connu. La littérature est aussi affaire d’intimité, ces avis ne se veulent pas objectifs. Ils veulent simplement tenter de partager une passion.
Je suis admiratif du travail de Philippe Claudel. Chacun de ses livres raconte une histoire sensible, émouvante, nouvelle. Et par une magie intéressante dont je vais tenter d’expliquer les rouages dans cette chronique, il arrive chaque fois à plonger son lecteur dans une ambiance particulière, que ce dernier ne sera pas près d’oublier. Par exemple, de son roman Les âmes grises, on ressort bouleversé. Je l’ai lu il y a déjà quelques mois et pourtant encore, sans savoir les mots exacts qu’il a employés, je revois la petite fille morte au teint blanc, le grand inspecteur au visage dur, l’usine monstrueuse, je me souviens de ses lignes sur la guerre que les personnages du livre subissent, entendent de loin. Les personnages de Claudel sont précieux et l’atmosphère qu’il installe toujours plus saisissante et inoubliable.
Dans cette chronique, je voudrais vous inciter à vous plonger dans Quelques-uns des cent regrets, paru en 2000 (en Poche depuis 2006). Philippe Claudel arrive avec des belles phrases à raconter non pas une histoire mais des histoires, à dresser des portraits d’hommes et de femmes avec une réalité bouleversante.
Le roman raconte l’histoire d’un homme qui retourne dans le village de son enfance pour enterrer sa mère qu’il n’a pas vu depuis seize ans. Pas très drôle, en effet.
Quelques lignes résument tout aussi bien le ton du livre que sa trame :
« Aujourd’hui, j’ai le regret de ce temps de lumière, comme j’ai le regret d’indicibles émois. Je suis parvenu de l’autre côté de la vie, déjà, moi qui ne suis pourtant guère vieux. J’ai franchi le seuil du pays qui nous fait regarder derrières nos épaules ce que nous ne pouvons plus caresser, car nous savons devant nous une issue cendreuse. L’espoir a cédé devant la mélancolie. Les couleurs fanent, comme les joues et les rires. Je ne peux recueillir les fleurs jadis entr’aperçues. J’ai passé seize années de ma vie comme un lâche au cœur mauvais, sans un mot griffonné, sans un signe, loin de celle que j’aimais, loin de ses yeux et de ses gestes, et de sa peine qui sans doute ouvrait en elle chaque matin une neuve blessure.
Je n’y puis rien.
Ma mère est morte et je n’étais pas là. »
Cette dernière phrase, « Ma mère est morte et je n’étais pas là. », je la trouve magnifique, car vraie, et on sent la radicalité, le poids du regret. On m’a dit un jour, il n’y a pas si longtemps, que la littérature n’était pas affaire de jolis mots. C’est sûr. La littérature ne doit pas dire, ne doit pas enjoliver, elle doit susciter des émotions avec précision et de façon concrète. C’est en cela que la dernière phrase de cet extrait est saisissante. Bien sûr, si on se base sur le début de ce passage, on remarque que le style de Claudel est très travaillé, avec des « beaux » mots. Mais le texte n’en pâtit pas, au contraire, car ces phrases mélodieuses, je pense, produisent un effet certain chez le lecteur.
« Ma mère est morte et je n’étais pas là », ça résume ce magnifique livre qui nous entraîne à la fois dans le présent et le passé du personnage principal : on lit des phrases sur l’enterrement de sa mère puis certaines sur les souvenirs qu’il a d’elle, que ce village fait ressurgir par moments. Sans transition ou presque. Des visages, des parfums, des couleurs, tout est prétexte à se rappeler et les mots qu’emploie Claudel sont souvent très justes.
Les personnages, nombreux, viennent et reviennent à mesure que le récit avance, et on s’y attache, on s’attache aussi aux lieux du village, village ravagé par une inondation, on s’attache à cette mère qu’on sait pourtant morte dès le début. Le curé, le grand-père, l’ouvrier de l’abattoir, l’aubergiste, le chauffeur de bus… On est surpris, à la fin, de les connaître tous si bien.
Le narrateur, celui qui enterre sa mère, parle à la première personne ; il est plutôt passif, il subit les évènements ; Claudel ne nous dévoile même pas son nom ! … avec tous ces procédés qu’on remarque à peine à la première lecture, le lecteur devient cet homme submergé par sa propre mémoire. Le « je » devient véritablement « je » pour celui qui lit ce roman, c’est peut-être là sa force : on s’approprie les souvenirs, les malheurs, la tristesse ; le village du personnage devient notre village d’enfance, les regrets du personnage deviennent nos regrets.
Et comme dans chacun de ses romans, Claudel nous agrippe quand on s’y attend le moins : une intrigue jaillit de nulle part. C’est le cas dans un autre de ses romans, La petite fille de Monsieur Linh, que je conseille également : un vieil homme, Monsieur Linh, se lie d’amitié avec un autre homme qui ne parle même pas sa langue. Ils se retrouvent chaque fois sur le même banc. Et quand un jour l’autre homme ne vient pas, on est intrigué, on panique, presque autant que Monsieur Linh. On est pris. Dans Quelques-uns des cents regrets, c’est la même chose. Un petit enfant mystérieux s’en va en courant chaque fois que le personnage s’en approche ; une clé, celle de la maison de sa mère, que lui remet le notaire, devient l’objet d’un fantasme. Des petits riens qui font qu’on tourne les pages plus vite : on veut comprendre.
Le regret est le thème principal du roman, vous l’aurez compris. Et si on arrive à toucher du doigt ce sentiment mystérieux, c’est en lisant des phrases splendides comme : « Ma mère est morte par moi, cela est sûr […]. Elle qui fut la plus parfaite des mères, je l’ai laissée un matin partant comme un voleur à la petite semaine, sans un mot griffonné, sans une explication, à peine une colère. J’ai tiré la porte et un trait […]. Puis la gêne a pris le relais, ainsi que la jeunesse oublieuse, l’usure des jours qui creuse les désirs aussi sûrement que l’acide, et qui fait qu’il est de plus en plus malaisé de tendre de nouveau la main, de pousser une porte, de dire un nom. Maman s’appelait Éliséa. » Cette mère décédée est évoquée dès le début du roman, elle est l’objet du livre, et on apprend son nom à la page 116 ! C’est cela le génie de Claudel : révéler l’essentiel au compte goutte, et chacune de ces gouttes entraîne une grande respiration, un frisson agréable. Page 116 : « Maman s’appelait Éliséa. », et les poumons du lecteur se remplissent d’un coup, c’est un soulagement énorme, les crispations disparaissent. On ne voulait pas savoir son nom, on ne s’était même pas rendu compte qu’on ne connaissait pas ce nom, mais le connaître crée quelque chose d’indicible.
Des révélations, ce livre en est truffé. Il faut le lire avec attention et se laisser porter par les images que créent les phrases justes de Claudel.
Edgar Dubourg