Bien avant le succès du récent Freedom (que je précise ne pas avoir lu), Jonathan Franzen recevait en 2001 le National Book Award pour ses Corrections (éditions de l’Olivier, 2002 ; Points, 2003). Ce roman de sept-cent pages décrit la lutte quotidienne, le matérialisme mesquin, les mauvais sentiments qui animent les cinq membres d’une famille de la classe moyenne américaine. Le titre évoque l’échec auquel est vouée toute tentative d’affranchissement du legs familial et, plus largement, du legs culturel.

Les Corrections sont une incontestable réussite d’un point de vue psychologique. La capacité de Franzen à faire vivre cinq personnages d’âge et de tempérament très différents impressionne. Les descriptions hautes en couleur des manies des uns et des autres, la peinture de leur crédulité ici, de leur méchanceté là, apportent leur lot comique. Le narrateur ironise et taquine beaucoup sans jamais juger. Il met en évidence les ressors utilitaristes de la solidarité familiale. Ceux qui ont vu le récent Jasmine de Woody Allen retrouveront dans les Corrections le thème de la facilité avec laquelle parents et enfants, frères et sœurs, peuvent se pourrir mutuellement la vie.
On aimerait cependant laisser l’aspect psychologique de côté, et proposer un autre niveau de lecture. Les Corrections offrent en effet un éclairage fascinant sur les transformations des économies occidentales, elles-mêmes en quête d’une nouvelle planche de salut. A l’image d’un Balzac en son temps, ou d’un Houellebecq aujourd’hui, Franzen souligne la vacuité et l’instabilité d’une économie basée sur la réputation, l’image, la spéculation. Il questionne la relation entre valeur d’usage et valeur marchande. Il observe la difficulté de nos sociétés à se projeter collectivement dans l’avenir alors que les besoins matériels sont largement couverts.
Chacun des cinq personnages est le reflet d’une correction économique dont il n’est pas dit qu’elle soit pour le meilleur. Passons-les en revue.
Alfred Lambert (Al), le père de famille affecté des maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Il fut l’homme du vingtième siècle : courageux, droit, ingénieux, animé par le sens du devoir. Il dirige pendant de nombreuses années les services techniques de la Midland Pacific Railroad, une compagnie de chemins de fer régionale offrant un maillage généreux dans les zones rurales sous-peuplées. Au seuil de sa retraite survient la catastrophe : la Midland est rachetée par Orfic, un empire financier composé d’hôtellerie de luxe et de pétrole, dont l’une des premières décisions est de fermer le réseau secondaire et de détruire des installations toutes neuves afin d’en récupérer le cuivre. La logique de profit l’emporte sur celle de service.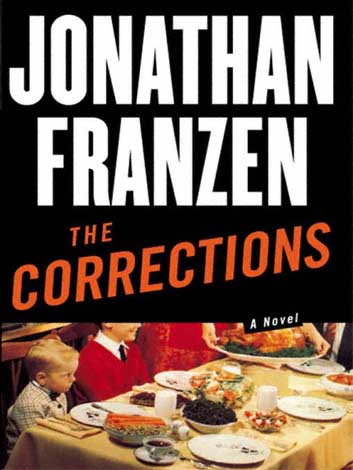
La dégénérescence d’Al, son repli sur une sphère privée de plus en plus étriquée, reflète la fin d’un monde où l’espoir était permis, où le travail avait un sens. Le retournement est porté jusqu’à son comble par le fait qu’Al refuse de négocier avec une grande compagnie pharmaceutique la vente d’un brevet qu’il a lui-même déposé du temps où il travaillant à la Midland. Tandis que sa femme et son fils le poussent à demander beaucoup plus d’argent au vu des bénéfices attendus de l’application industrielle, Al s’obstine à répondre qu’il n’en a pas besoin. Il s’enterre avec ses principes.
Menacée de toutes parts d’une vie familiale et sociale en voie de dislocation, sa femme, Enid, cherche coûte que coûte à défendre son statut. Elle s’accroche à de vieux repères, à de vieilles antiennes. Fêter Noel en famille est son objectif suprême, son rempart contre la folie. Enid compare systématiquement sa réussite matérielle, et celle de ses enfants, au sort des autres, et s’en trouve profondément frustrée. La croisière de luxe dans laquelle elle réussit à entrainer Al est un ultime sursaut d’orgueil, qui pourtant se résume à sa profonde honte d’avoir à voyager en classe économique. Pour paraphraser Brel, on dirait qu’elle « aimerait bien avoir l’air, mais n’a pas l’air du tout ».
Malgré leurs disputes régulières, Gary, le fils aîné, est celui qui partage le plus l’idéal matérialiste de sa mère. Cadre dans une banque d’affaire, Il appartient à ce monde de la finance aux profits faciles, pourvu qu’on ait les bons réseaux afin d’avoir toujours une longueur d’avance. Il incarne une forme de réussite sociale de plus en plus répandue, à la merci toutefois des aléas boursiers. C’est justement là que le bât blesse : il peine à maintenir ses performances et l’apparence d’une success story familiale. Défait, il finit par avouer à sa femme – parfaitement tyrannique au demeurant – que, oui, il est déprimé, humiliation suprême. La bulle menace d’éclater.
Restent Denise et Chip, les vilains petits canards, ceux par qui on voudrait voir la lumière arriver. Denise, comme son prénom l’indique, est l’antithèse de sa mère : rebelle, indépendante, prête à prendre des risques pour tracer sa propre route. Elle est pourtant le jouet d’une époque dans laquelle la capacité de séduction joue un rôle central. Ce n’est qu’au gré de ses multiples conquêtes masculines et féminines que Denise gravit les échelons dans le monde de la restauration. La cuisine créative à laquelle elle s’adonne excite autant les critiques en vogue qu’elle ne laisse sceptique ses parents. Enid dit de sa fille qu’elle « s’abim[e] les mains et gâch[e] sa jeunesse » dans un restaurant « bruyant », où le repas « avait été excellent bien que beaucoup trop riche ». (p.153). L’ascension de Denise atteint des sommets quand elle se retrouve propulsée à la tête du Generator, un restaurant de luxe né de la transformation d’une ancienne centrale à charbon de Philadelphie.
Chip, quant à lui, est un intellectuel raté pris au piège de ses propres contradictions. Son enfance est pleine de promesses puisqu’il passe de nombreuses heures à épauler son père dans ses expériences chimiques menées dans le sous-sol de la maison familiale, et remporte plusieurs prix. La puberté a cependant raison de son intérêt pour la science. Il finit par s’embarquer dans une carrière universitaire du côté des sciences sociales, s’adonnant sans relâche à l’étude des théoriciens (souvent français) de la déconstruction, qui ont connu un certain succès aux Etats-Unis. Chip entre en résistance culturelle, s’échinant à démontrer le caractère maladif et asservissant de la société de consommation.
Pas de chance : lui-même est l’esclave de son désir pour les femmes, qu’il traite bien inconsciemment comme des objets sexuels. Chip est licencié après avoir eu une relation avec l’une de ses étudiantes et se retrouve sans ressources. Ses tentatives littéraires échouant pitoyablement, il ne lui reste plus qu’à vendre son âme au diable. Croisant la route d’un diplomate lituanien reconverti dans l’économie criminelle, il met sa plume au service de ce dernier afin d’attirer des capitaux dans un pays livré à la privatisation sauvage. Avec jubilation, Chip devient complice du système capitaliste. D’un positionnement moral, il embrasse une posture cynique.
Chacun donc en prend pour son grade dans les Corrections, qui dressent un tableau inquiétant de la direction que prennent les sociétés occidentales. Sur le terreau d’une industrie et d’une culture scientifique déclinantes prospèrent des activités de valeur douteuse. Toute tentative d’émancipation du système parait stérile tant les individus en sont devenus complices. Comment en effet résister à la tentation de vendre de la poudre aux yeux et à l’argent facile ? Peut-on sincèrement critiquer d’un côté l’asservissement à la consommation sans dénoncer du même coup la libération des mœurs sexuelles ? L’individualisme libéral se retrouve pris à son propre piège.
Il est intéressant, pour finir, de dresser un parallèle entre les Corrections et la vision proposée près de dix ans plus tard par Michel Houellebecq dans La carte et le territoire. Houellebecq semble pousser les craintes de Franzen plus loin en imaginant la disparition de l’industrie, des savoir-faire, et la marchandisation de l’art et des traditions. La France est appelée à devenir un grand terrain de jeu touristique aseptisé, taillé sur mesure pour les riches Russes et Chinois. Tout ne deviendra que fiction consommable.
La différence est que Franzen ne plonge pas avec autant de délectation dans le constat d’une déliquescence morale généralisée. Les Corrections mettent le doigt là où ça fait mal, mais se gardent de toute fascination pour le pire. Elles suggèrent notamment la résilience de la cellule familiale, et semblent croire en un fond de bonne volonté, de sens moral et d’orgueil chez les individus. On sourira à cette suggestion, mais il serait bon que cette petite dose d’optimisme américain soit possible en France.
Renaud Thillaye
3 Commentaires
Brillante démonstration pour un roman non moins brillant. Merci.
Merci de ce très riche compte rendu qui dégage les “bonnes questions” pour aujourd’hui écrit par une plume alerte, éclairante et très agréable à lire. Et dans le fond, le pire n’est pas toujours certain …
Merci!