Il est urgent d’être utopiste
D’une première tentative d’Edouard Glissant
“Clic” ; instantané ! C’est peut-être l’abus de mots et de gestes aujourd’hui qui provoque notre réaction, celle de vouloir photographier une réalité. La nécessité d’un référentiel commun, l’importance du constat : Edouard Glissant nous offre sa lucidité. C’est ici que nous devrions (re)commencer.
Ce Martiniquais n’a pas la prétention d’être un intemporel. Il écrit pour un espace, notre espace-temps européen, avec l’anticipation clairvoyante dont il a été doté. L’étendue du travail de Glissant est immense et transversale ; pourtant c’est avec précision qu’il photographie les déviances d’un modèle qui est le nôtre, et suggère une lecture simple et épurée du brouhaha, qui est le nôtre aussi.
.
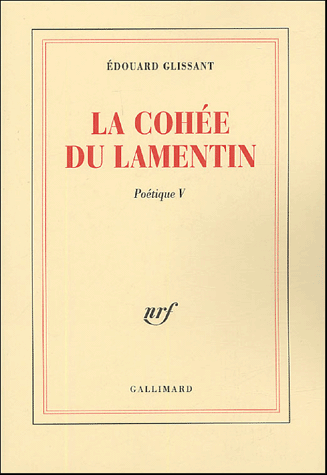
La notion retenue ici sera celle de la “créolisation” qu’introduit Glissant dans La cohée du Lamentin, cinquième volume de sa Poétique, paru en 2005, où il en revient à la géographie. Loin des frontières physiques et statiques hobbsiennes, sa géographie est dynamique, mouvante, interactive, fondue ; elle est un vecteur qui devrait nous être commun ; Glissant insiste : le paysage.
C’est au sein de nos paysages que prend forme la “créolisation” ; vous la vivez, même vos grands-parents l’ont connue, elle est un contact charnel entre les cultures, ce frottement physique entre résidents de ces “espaces insulaires” d’un archipel qui serait le monde. Cette échange sensible, s’il n’abolit pas le préjugé des obstinés, il les confronte. La “créolisation” c’est ton père blanc français qui épouse ta mère noire antillaise, c’est aussi ton débat animé avec le turc qui est en Erasmus, ou ta petite copine qui est lituanienne. Ces interactions réelles et concrètes créent des liens puissants entre nos petites individualités et met en place les conditions de la solidarité, et donc, de la citoyenneté.
.
Pour ce qui est de l’Europe, Glissant semble incarner l’optimisme poétique dont nous avons besoin et qui domine grandement les clivages politico-économiques que nous semblons résignés à encaisser. Pourtant, agir et participer à la construction et au perfectionnement de notre espace est un droit sinon une persévérance naturelle de l’être qui ne revient pas exclusivement à ceux qui en sont natifs ou qui s’en voient rattachés les moyens juridico-politiques.
.
“L’utopie n’est pas le rêve, elle est ce qui nous manque dans le monde. Voici ce qu’elle est, cela qui nous manque dans le monde. Nous sommes nombreux à nous être réjouis que le philosophe français Gilles Deleuze, ait estimé que la fonction de la littérature comme de l’art est d’abord d’inventer un peuple qui manque. L’utopie est le lieu même de ce peuple. Nous imaginons, nous essayons d’imaginer ce qui en serait si nous ne pouvions pas inventer cela, quand même nous ne saurions dire ce qu’est cela. Sauf que nous savons qu’avec ce peuple et ce pays peuplé nous serions et nous sommes plus près du Monde, et le Monde, plus près de nous.”
Nous le savons tous, en particulier nous, dont l’identité est plurielle : les frontières de notre nation française vont bien au-delà de ses limites étatiques. Notre métissage enrichit notre espace, et loin de le démanteler, il le consolide dans son intégrité. Notre modèle est celui d’une communauté ouverte, de rencontres, d’influences, d’interactions physiques et intellectuelles –civilisationnelles aussi. Voilà l’instantané de Glissant, le nôtre, celui du citoyen-acteur.
.
Quoi, attendre en vain que le système s’actualise de lui-même et réalise notre réalité, modifie systèmes scolaires et clichés ? Ce présent instantané n’est que la puissance moins 30 du progrès ; mais Glissant inspire. Encore.
.
Cécile de Caunes
