On lit partout : « la série Harry Potter, la saga Harry Potter. » Les termes série et saga sont impropres, et la rectification s’impose, qui ne corrigera pas les mauvaises habitudes. Essayons quand même.
Les séries prolifèrent. C’est à la bande dessinée que je me référerai pour rappeler les critères du genre ; Tintin fera l’affaire.
De Tintin au pays des soviets (1930) à Tintin et les picaros (1976), Hergé a publié dix-neuf histoires en vingt-trois albums, – puisque quatre d’entre elles courent sur deux tomes, Objectif Lune et On a marché sur la lune par exemple. On peut les lire dans n’importe quel ordre, n’en ouvrir qu’un sur deux, car chaque œuvre se referme sur elle-même, les liens de l’une à l’autre étant ténus, voire inexistants. Les personnages principaux – gage d’unité – reviennent dans chaque album, mais aucun n’a ni parents ni enfance, pas de racines donc, pas de biographie non plus. Du reste, pas un ne meurt : Rastapopoulos survit à une chute dans un ravin (les Cigares du pharaon, 1934, p. 60) et, si Hergé avait le projet de tuer Tintin dans l’Alph-Art (1986, p. 42), il est mort lui-même avant d’y avoir réussi, si bien que, de façon symbolique, Tintin aura survécu à son dernier ennemi.
Vu de loin, Harry Potter a l’air d’une série avec ses sept titres bâtis sur le même patron : Harry Potter and the Philosopher’s Stone, …and the Chamber of Secrets, etc. ; vu de plus près, par le recours aux invariants. Les premiers tomes exposent chacun une aventure et l’enserrent entre fin août et fin juin, dans un Poudlard immuable, gouverné par des enseignants qui ne changent guère. Même les rapports au sein du trio Harry-Ron-Hermione semblent figés. En I comme en II, il y a une riddle (énigme) à résoudre et Tom Riddle (Jedusor) à repousser ; sauf que, dès le tome III, avec les détraqueurs, tout se détraque : non seulement Voldemort n’apparaît nulle part, mais surtout Harry revit la mort de sa mère. Dans le IV, la résurrection de l’Ennemi et la mort de Cédric sonnent le glas des fins heureuses. Ce sera pire dans le V avec la mort de Sirius, pire encore dans le VI, parce que Poudlard cesse d’être une citadelle inviolable, parce que Dumbledore est tué, parce que le médaillon qu’il avait arraché aux sortilèges de la caverne était un faux, signé R. A. B..
Avec les Reliques de la Mort, même si le récit commence presque chez les Dursley, même s’il y a toujours de la neige à Noël, c’en est fini de la stabilité, et ce septième tome progresse – joli motif – en sept fuites : fuite des sept Potter, au cours de laquelle Hedwige et Fol Œil sont tués ; fuite du mariage de Bill ; fuite du ministère de la Magie, où Hermione s’empare du médaillon de Serpentard ; fuite de Godric’s Hollow, où Hermione ramasse la biographie de Dumbledore, mais casse la baguette de Harry ; fuite de chez Xenophilius Lovegood, qui révèle au trio l’existence des reliques de la Mort ; fuite, qui coûte la vie à Dobby, du manoir des Malefoy, où Harry s’approprie la baguette de Drago ; enfin fuite de Gringotts, où Harry laisse échapper l’épée de Gryffondor, mais obtient la coupe de Poufsouffle. Le soir même, le trio arrive à Poudlard ; Rogue livre ses secrets vers minuit ; Voldemort meurt à l’aube. Il y a beau temps que la série a cessé d’en être une ; elle n’en a même plus l’apparence. À l’épilogue, Harry vit toujours, mais comme un mort au Panthéon : son acte est derrière lui. Avec un début, un milieu et une fin, le livre de J. K. Rowling est un cycle.
Qui dit cycle dit roman, et non saga.
À vrai dire, si le mot saga est passé dans l’usage, le genre proprement dit n’a eu que peu de durée, dans un espace restreint : la lointaine Islande au milieu du XIIIesiècle. C’est un récit en prose, qui rapporte des faits historiques ou tenus pour tels ; les personnages, situés dans une lignée, ont en commun d’avoir vécu ; et si l’auteur, souvent anonyme, a pris la plume, c’est pour fixer le souvenir de leurs exploits. Rien à voir avec une fiction quelle qu’elle soit.
Conformes à leur but, les sagas sont courtes : sur les quinze offertes en Pléiade, onze font moins de cent pages ; bien qu’elle suive deux héros successifs, Gunnarr et son ami Njâll, la plus longue – la Saga de Njâll le Brûlé, 1270 – n’en excède pas trois cents. Aucun rapport avec un texte en sept tomes, deux cents chapitres, trois mille quatre cent sept pages dans l’original en anglais ou quatre mille cinq dans la lucide et lumineuse traduction de Jean-François Ménard.
Pour le lecteur, il s’ensuit un autre rapport au temps, – et un paradoxe. On peut, à mesure qu’on avance dans la lecture d’une saga, oublier en partie le début. Les meurtres, souvent, s’accumulent, mais le dernier est la vengeance du précédent plus que du tout premier. Il n’en va pas de même dans Harry Potter, où il faut avoir retenu le détail de ce qu’on a déjà lu, et c’est immense, pour comprendre le détail de ce qu’on va lire. Fait-on retour au début, on découvre alors que la thématique de l’horcruxe se profilait – à l’état nébuleux, mais quand même – dans le fait que Harry parlait aux serpents.
C’est que Harry Potter, s’il éclaire la vie, reste du côté de l’art, alors que la saga, bien qu’œuvre d’art, s’accroche à la vie. Opéra ou tapisserie ou gratte-ciel en spirale, le livre de J. K. Rowling ne laisse aucune place au hasard, n’admet pas une ligne imposée de l’extérieur. Son monde emprunte à tous, mais ne doit qu’à elle-même. Elle ourdit sa toile avec une ingéniosité digne des performances de l’électronique, pour l’ériger en un dôme de lumière, semblable à celui sous lequel Voldemort a peur. L’auteur de saga, au contraire, doit « faire avec », transcrire comme mécaniquement ce que la légende disait déjà de son héros.
Pour se plier à cette contrainte, les auteurs de sagas ont fait de la soustraction un art : les descriptions sont rares, les analyses aussi ; les dialogues ne ralentissent pas le récit. L’intérêt naît de la litote, de l’humour froid, d’une implacable cruauté. L’auteur ni son héros ne se plaint ni ne s’explique. Aucun romancier contemporain n’a osé une telle rigueur ; en comparaison, La Chute d’A. – le chef d’œuvre de Friedrich Dürrenmatt, 1971, – paraît presque bavard.
À l’inverse, J. K. Rowling use de tous les procédés de l’écriture romanesque. Elle raconte – surtout, – mais, à l’occasion, elle suit Harry dans ses raisonnements et dans ses soliloques, elle imagine un décor, invente un dialogue, une lettre, un article, un décret, une page d’un livre : le conte de Beedle le Barde, le chapitre de la Vie de Dumbledore. Ce faisant, elle insère des récits dans le récit. Sa rigueur n’est pas moindre que celle d’un auteur de saga, mais tout autre : elle est libre.
Ni série ni saga, son livre est un roman.
François Comba
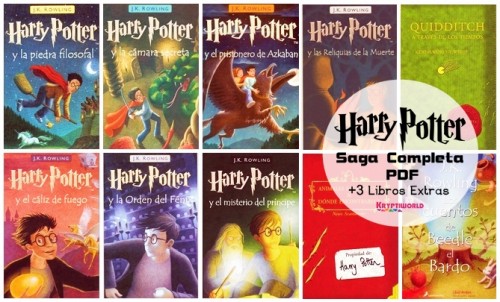

2 Commentaires
Bonjour Monsieur Comba,
Je dois dire que la lecture de votre article change encore ma vision de Harry Potter. Pourtant lectrice assidue des aventure de Harry Potter, que ce soit en français ou en anglais, vous éclairez encore des recoins des 7 tomes, et analysez d’une façon tout à fait unique les événements ou personnages des romans de J.K.Rowling. J’ai hâte d’être reçue à Science Po pour suivre votre cours consacré à ce cycle donc, et en attendant je me régale de vos articles.
Merci à vous et à bientôt j’espère,
Une fan de Harry Potter, donc de votre blog, et peut-être, pour mon plus grand plaisir, une future élève.
Bonjour Alice,
Merci de vos encouragements. Vos mots me touchent parce que vous êtes toute jeune et que c’est justement pour votre génération que je travaille. C’est pourquoi nous ne sommes pas sur mon blog, mais sur celui créé par Paul Grunelius, Quentin Jagorel, etc., c’est-à-dire des étudiants de Sciences Po qui n’ont jamais été mes élèves (les pauvres ^^), mais qui consentent à publier ma prose un peu surannée.
Bonne chance pour Sciences Po !