En 1963, Louis Aragon commençait sa préface au « Fou d’Elsa », considérable recueil de poèmes sur l’Andalousie arabe aux derniers jours, assiégée et agonisant à l’arrivée des Rois catholiques, par cette phrase qu’on pourrait trouver, du fait même de son caractère singulièrement diégétique, à la première ligne d’un incipit de roman ou, sur fond noir, au pré-générique d’un film d’Elia Kazan : « Tout a commencé par une faute de français ». Le poète entame, par ces mots, le récit d’une très longue histoire, celle de la poésie, ou, disons-le plus calmement, de sa poésie, celle qu’il a aimée, celle qu’il a écrite.
Dans cette préface, Aragon décortique sa découverte fascinée, un soir de solitude de l’année 1960, du premier vers d’une vieille chanson retrouvée dans un numéro de « Ménestrel, journal de musique », une revue du XIXème siècle oubliée depuis longtemps, et qui dit : « La veille où Grenade fut prise ».
« La veille où Grenade fut prise »
Lisez ces six mots à voix haute, et peut-être sentirez-vous ce qu’Aragon a senti, ce qu’il a appelé une beauté, un appel à l’imagination, une songerie dans la Grenade aux derniers jours ou, de manière encore plus étonnante peut-être, une amertume à l’oreille.
Alors, rien ne vous choque ? Vraiment ? Ne voyez-vous pas un déséquilibre étrange, comme si le code génétique de la phrase était erroné, n’y a-t-il pas un mystère là, dans la subtile fulgurance de cette phrase anodine, dans cette contraction langagière ?
Il y a une faute. Une faute de français. Il faudrait naturellement dire « la veille du jour où Grenade fut prise ». Pourtant, Aragon voit là une beauté, et non pas malgré, mais du fait même de l’incorrection de la phrase. Si on y insérait effectivement « du jour », la bizarrerie douce à l’oreille qui réside dans la sonorité chancelante de ce vers disparaîtrait instantanément, car la structure deviendrait laborieuse, inutilement alambiquée (il serait à la limite plus joli de dire dans ce cas : « la veille de la prise de Grenade »). C’est donc ce murmure des mots, un peu semblable au souffle du conteur qui, à la veillée au coin du feu, commence son récit d’un geste de main dessinant l’horizon, les sourcils froncés, face aux regards à l’affût de quelques enfants fascinés ; c’est donc cette mélodie de la langue qui produit la beauté poétique de ce simple vers. Mais ce n’est pas tout. Car pourquoi y aurait-il plus grande beauté dans « La veille où Grenade fut prise » que dans « La veille de la prise de Grenade », les sonorités des deux propositions étant quasiment similaires ? On est bien libre de penser le contraire, mais Aragon estimait sans doute –il ne le dit pas– que la première tournure a une supériorité syntaxique considérable sur la seconde, en ce qu’elle est passive, c’est-à-dire qu’elle nous projette de fait du côté des Arabes, des vaincus. Aragon reprend un peu plus loin : « Je m’identifiais avec le roi de cette ville mythique, ce Boabdil dont je sais bien comment il a pénétré dans mes rêves, mais pouvais-je vraiment, et dans quel miroir, me voir sous les traits de ce personnage dont apparemment l’image déformée est née de la poésie espagnole, du romancero morisque, de la légende ennemie ? ». L’agencement si fragile de ce vers, peut-être dû d’ailleurs à une réelle lacune syntaxique de l’auteur de la chanson (mais quelle importance ?), génère donc un renversement de la vision. Peut-être est-ce cela, la poésie, un retournement du miroir par l’action du phrasé. Et dire qu’il a fallu passer par l’erreur, par la transgression du langage normatif, pour arriver à cette justesse !
Plus de vingt ans avant d’écrire cette préface au « Fou d’Elsa », Aragon parlait déjà de sa passion pour l’erreur dans le langage (il héritait cela d’Apollinaire, sans doute), dans un texte plus connu, la préface aux « Yeux d’Elsa ».
Cette fois, il prend l’exemple de deux vers de Rimbaud (« Patience (D’un été) ») :
Des chansons spirituelles voltigent partout des groseilles, avez-vous dit ? Si je ne m’abuse, ça ne veut rien dire. Qui voltige, les chansons ou les groseilles ? Les chansons qui voltigent, d’accord, on comprend ; mais des chansons qui voltigent des groseilles, on comprend moins. Voltiger n’est pas un verbe transitif, allons ! En réalité, il semblerait qu’il faille lire « Voltigent parmi les groseilles » : l’incorrection syntaxique ne serait alors pas une volonté de Rimbaud. Ce n’est pas le problème d’Aragon qui explique : «tant que je vivrai, je lirai Voltigent partout… ». Il voyait dans ce creux au centre de l’expression, dans cette anomalie, comme le pied trop court qui rend la chaise bancale, une beauté (une syllepse, très exactement), et non une faiblesse. Il ne faut pas entendre par là qu’il suffirait de truffer de fautes de français tous nos textes pour devenir des poètes, mais bien cependant que le poète peut, par « l’alchimie du vers, transformer en beautés des faiblesses ». Le poète en ce sens est un roi qui a le droit de fléchir le verbe (de « twister les mots » comme disait Jean Ferrat), de bousculer la norme (seulement utile à « quelque baccalauréat », se moquait Aragon).
Dans cette même préface, on trouve beaucoup d’exemples, dont le plus frappant est sans doute cette citation de Rotrou (dans « Venceslas ») : « Apprenons l’art, mon cœur, d’aimer sans espérance ». La syntaxe, encore une fois, est ici chancelante, extrêmement discutable d’un point de vue normatif, pourtant elle donne toute sa force au vers : l’amour est lié au manque d’espérance et, du même coup, l’art d’aimer s’effiloche, il n’a pas d’unité. Ecrire « Mon cœur, apprenons l’art d’aimer sans espérance » eût été déclamatoire, écrire « Apprenons l’art d’aimer sans espérance, mon cœur » eût été langoureux, écrire enfin « Apprenons, mon cœur, l’art d’aimer sans espérance » eût été laid.
Cette faculté à créer des syllepses est sans doute un des attributs du génie esthétique, et elle est universelle, car Demy ne fait pas autre chose que Rotrou avec ce « mon cœur » quand il insère, dans les « Parapluies de Cherbourg », au milieu d’une scène et sans discontinuité sonore, un mystérieux plan en travelling dans une galerie à colonnes.
Et ce qu’il a aimé dans les poèmes des autres, Aragon l’a tenté dans ses œuvres à lui. Dans « Les poètes » (Spectacle à la Lanterne magique), il écrit :
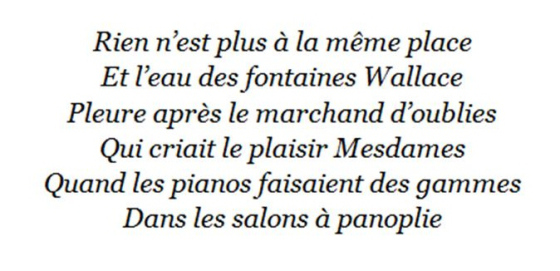
Si cette strophe est sublime, c’est en grande partie grâce à ses « fautes de français ». Les pianos faisaient des gammes ? Non, les pianistes ! Mais c’est tellement plus beau, dit ainsi. Le marchand d’oublies criait le plaisir Mesdames ? Il aurait sans doute fallu écrire : Qui criait « Au plaisir Mesdames !», ou Qui criait « Le plaisir, Mesdames !», ou Qui criait, « A votre plaisir, Mesdames !» ; pourtant l’incrustation de « Mesdames » dans ce discours indirect est une idée simple mais superbe, comme une vocalisation furtive du passé révolu.
Et tout ceci va bien au-delà de la simple question du beau poétique, car Aragon et ceux qui le suivent dans cette voie disent en substance qu’il y a du beau parfois là où il y a du faux, que la transgression a une valeur souvent inestimable, et que la norme est là pour être contournée. En conséquence, le vers régulier, s’il est seul et jamais discuté, étouffe le chant qui monte de la terre et de l’histoire toute entière de la France, c’est-à-dire ce que nous sommes, « le sanglot organique et profond » de notre peuple.
S’il est formulé dans le contexte troublé de 1942, le message d’Aragon, déployé sous la forme d’un Art poétique, a une dimension résolument intemporelle : la norme étouffe l’expression humaine et mène au pire écueil qui soit, l’ignorance absolue de la complexité du monde.
Quentin Jagorel

4 Commentaires
Sublime analyse par le fond et par la forme !
Très bel article, que je découvre par hasard, merci !
Merci … Sans espérance
Moi-même poète cette sublime analyse me parle….Merci!