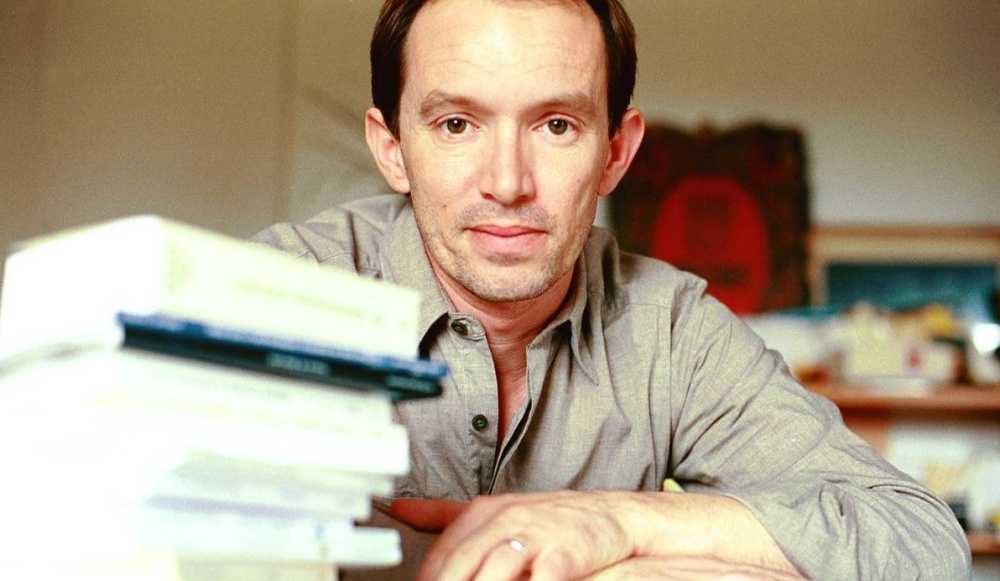Entretien avec le romancier Laurent Mauvignier qui, avec “Autour du monde” (éditions de Minuit), s’affirme comme un des auteurs phares de la rentrée 2014 et continue d’imposer sa puissance narrative dans le paysage littéraire contemporain.
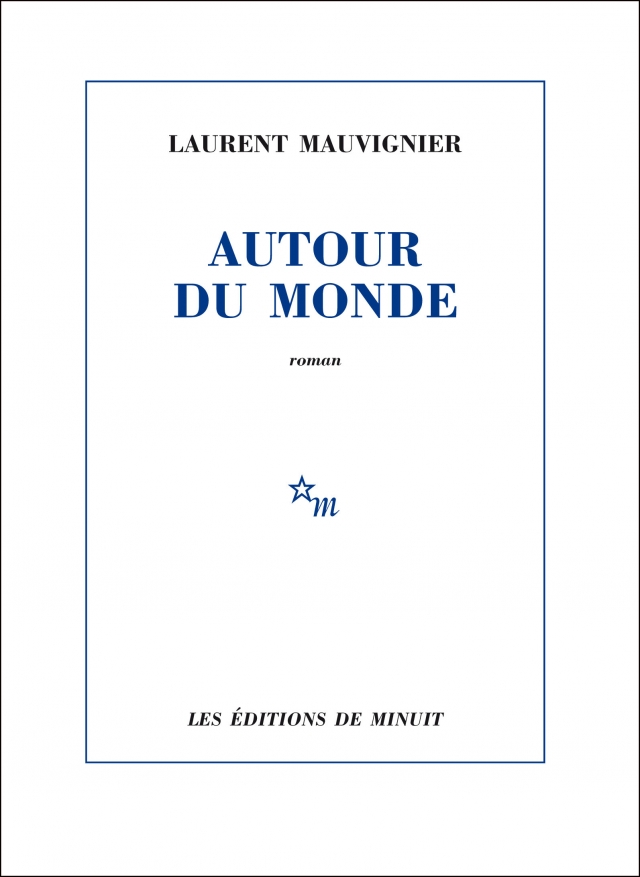
Le 11 mars 2011, à 15h30, une vague de quinze mètres de hauteur ravage les côtes de la préfecture de Fukushima. Quelques heures plus tard, à plus de 130 000 kilomètres du Japon, la vague percute la calotte glacière et entraîne la formation d’icebergs géants.
De la même façon que les catastrophes naturelles qui frappent des points précis de notre planète peuvent avoir une répercussion sur l’ensemble du globe, un drame local devient inexorablement aujourd’hui une tragédie collective. Un événement que l’on reçoit de plein fouet, que l’on s’approprie ou que l’on rejette. Mais un événement qui passe d’ondes à ondes, de satellites en connexions, un événement que l’on relaie.
C’est ce relais que nous présente Laurent Mauvignier dans son dixième et nouveau roman Autour du monde. Quatorze destins de voyageurs, liés ou non au séisme, qui au gré de leurs trajets en avion ou de leurs périples intimes voient leurs parcours modifiés par l’annonce de la vague et de la menace nucléaire sous-jacente. Un récit rotatif donc, de plus de quatre cent pages, qui présente des fragments de vies qui « se frôlent et ne se rencontreront jamais. »
Profondeur de Champs : Comment le projet narratif d’Autour du monde a t-il pris forme ?
Au départ, un projet de théâtre, avec l’idée de trouver un lieu qui serait à la fois unique et multiple, un lieu de passage, un lieu en commun. J’ai entendu parler d’un fait divers à la radio, qui s’était passé dans un jardin public. Le fait divers en question ne m’avait pas marqué, mais le jardin public, l’idée d’un espace où les gens se croisent, se frôlent, où les histoires des uns et des autres peuvent cohabiter mais sans jamais se rencontrer vraiment, cette idée, elle, m’avait non seulement frappé, mais s’est installé en moi pendant des mois, le temps de se transformer, de passer du jardin public à l’idée de la ville touristique, puis de la ville au monde lui-même, comme s’il était un vaste jardin public. La question de comment se vit l’intime dans un monde où l’espace est devenu entièrement public.
Un tel projet narratif a dû nécessiter un important travail de documentation et de recherche, comment avez-vous procédé ? Vous êtes vous rendu sur les lieux que vous décrivez ?
Pour moi, me rendre sur un lieu dans l’espoir d’écrire à partir de lui, c’est-à-dire regarder ce lieu en y prenant des notes, c’est une difficulté presque indépassable, ou inconciliable avec le besoin de cadrer le récit, ou, du moins, le lieu du récit. C’est comme si, en allant sur place, tout s’offrait à moi, que ce soit du coup trop difficile de l’enfermer dans le cadre d’une image. En revanche, lorsque je décide d’un lieu que je ne connais pas, je vais chercher de la documentation dans des livres, dans des films, sur Internet, dans des forums de touristes, etc. Sur Google Earth par exemple. Et là, tout de suite, le lieu s’abolit, se dissout dans le récit qu’on en fait, il se transforme en possible littéraire, parce que les mots l’investissent, ou les images. Je lis énormément de romans sur un lieu, et c’est comme si j’allais chercher avec une pince à épiler le moindre effet de réel, la moindre image qui donne une impression de vie, qui a une force d’évocation.
La difficulté, c’est de ne pas sombrer dans l’exotisme. C’est pour cette raison qu’il faut trouver des détails très précis, histoire de ne pas encombrer l’image avec des généralités, des banalités. La notation juste, pointue, donne la vie d’un lieu sans nuire au récit, et le laisse au contraire se déployer à sa juste mesure, sans exotisme, sans volonté de faire comme si j’étais allé là-bas et de montrer que j’y étais allé. Quel que soit le lieu, il faut le montrer comme si c’était simple et banal d’y être, ne pas s’appesantir. C’est plus facile en trouvant des documents qu’en observant soi-même, car le réel est toujours un peu trop englobant et difficile à circonscrire.
Le relais de la narration entre les personnages s’effectue par des connecteurs logiques mais aussi par le biais de photographies « touristiques », comment ces photos ont-elles été collectées ?
D’abord, je dois préciser que les photos ont plusieurs fonctions : lorsque j’ai renoncé à l’idée de chapitre, parce qu’il me semblait qu’un chapitrage compartimenterait trop le livre, qu’il irait à l’encontre du projet lié à la mondialisation, à l’effacement par la vitesse, à la dissolution de l’espace, j’ai voulu lier les récits par un flux, une écriture extrêmement linéaire et comme traversant l’espace du récit, comme une flèche, comme si c’était l’écriture la vague, le « corps conducteur », comme dirait Claude Simon. Mais j’ai pensé qu’il fallait tout de même une ponctuation, un marqueur pour signifier le changement d’histoire, mais une ponctuation qui serait inclue dans le dispositif global, qui serait dans le mouvement du dispositif ; à la fois marqueur et relance.
Et puis, pour un livre qui parle de voyageurs, de départ, de tourisme, je pensais à tous ces livres de voyages, ces carnets de voyages, ces soirées diapos comme il n’en existe plus depuis Internet (tout le monde envoie ses photos et ne les partage plus comme autrefois, autour d’un verre, le soir d’un retour, où photos et récits permettaient aux touristes de se vanter de leur voyage et de faire rêver leurs amis et famille. J’aurais voulu intégrer une histoire comme celle-là, mais ce n’est plus trop possible aujourd’hui, j’ai donc laissé tomber), je pensais aux croquis, aux esquisses, et puis à tous les forums sur internet, où chacun accompagne son descriptif par des photos.
J’ai donc décidé qu’il y aurait des images, même si pour Des hommes la question d’insérer des images m’avait déjà traversé l’esprit. Les photos que mon père avait rapportées de la guerre d’Algérie avaient servi à construire le livre, j’avais hésité à les intégrer, mais c’était impossible parce que ça aurait été leur imposer un scénario que la réalité de l’histoire familiale ne pouvait pas accréditer. Pour Autour du monde, j’ai envoyé un mail à peu près à tout mon mailing, en demandant aux gens, s’ils étaient allés dans tel ou tel endroit, de m’envoyer les photos touristiques qu’ils avaient prises. Certains se sont prêtés au jeu très volontiers, d’autres avec plus de réticences parce qu’ils avaient des images trop banales, trop touristiques. D’autres, au contraire, des images suffisamment étonnantes (la photo de Marie Nimier avec les mains de la vieille dame dans l’avion, par exemple). Et puis certaines se répondent bien, elles ont du sens pour moi, par exemple le lion en Tanzanie suivi par le lion de pierre, dans la même position, de Rome. Les images sont aussi des relais, elles évoquent des relations entre certaines histoires.
Dans Autour du monde, on ne suit les parcours de vie des personnages que très peu de temps. Le temps que l’annonce du tsunami percute leur vie. A une époque où l’information instantanée est en flux tendu, pensez-vous que l’écriture romanesque se calque consciemment ou inconsciemment sur cette rapidité ?
D’abord, je ne pense pas que le tsunami percute la vie de tous les personnages. Le plus souvent, au contraire, à part dans la première et dans la dernière histoires, les personnages vivent le tsunami et la présence du monde comme une rumeur médiatique, presque dénuée de réalité à force qu’elle s’éloigne d’eux, dans l’espace. Ceci étant dit, il est vrai que dans ce livre, le projet était lié à la vitesse, à l’effacement, au flux de l’information. Mais pas seulement, c’est la vitesse du déplacement. Cette question n’est pas récente en littérature, Baudelaire l’avait déjà signalé dans son poème « A une passante », l’idée de ce frôlement des êtres, du mouvement qui nous rapproche et nous éloigne les uns des autres dans le même temps. Et puis, le roman, la fiction en général, se construit toujours avec l’idée d’un début, milieu et fin. Comme si dans la vie, on avait une organisation, une structure aussi rassurante… Il n’y a pas de centre du monde, il n’y a pas de début milieu fin, il y a un glissement permanent, une fluctuation, une circulation des êtres, du temps, de l’espace.
Il n’y a pas de centre du monde, il n’y a pas de début milieu fin, il y a un glissement permanent, une fluctuation, une circulation des êtres, du temps, de l’espace
Un des personnages de votre roman aperçoit à la télévision « Yûko », une jeune japonaise rescapée du tsunami et s’interroge sur la vie de cette jeune fille. Avez-vous la sensation que l’écrivain aujourd’hui doit se suppléer aux médias de masse qui eux omettent de « raconter » les histoires des victimes des événements ?
Suppléer, ce serait prétentieux, non ? Mais en tout cas, ce que j’aime dans le roman, c’est que c’est un art qui va complètement à l’encontre des injonctions de notre époque ; là où on l’on exige de la transparence et de la vitesse, le roman peut prendre le temps de montrer que les situations, les êtres, les relations de cause à effet, peuvent être complexes, difficiles à comprendre. Le roman est un art qui restitue au réel son épaisseur et son opacité, sa beauté faite de mille et une chose. Pour autant, il ne s’agit pas d’ignorer la sensibilité de notre époque, sa vitesse, son regard imagé, mais d’y plonger sans céder aux facilités de l’air du temps… Montrer qu’une victime n’est pas que ce moment qu’elle a vécu, mais qu’il y a derrière et devant elle une histoire qu’il faut prendre en compte, parce que la victime, ce drame qu’elle a vécu, elle le vivra différemment selon sa propre histoire, son expérience, son imaginaire, etc.
Lire ICI la suite de l’entretien.
Propos recueillis par Agathe Charnet